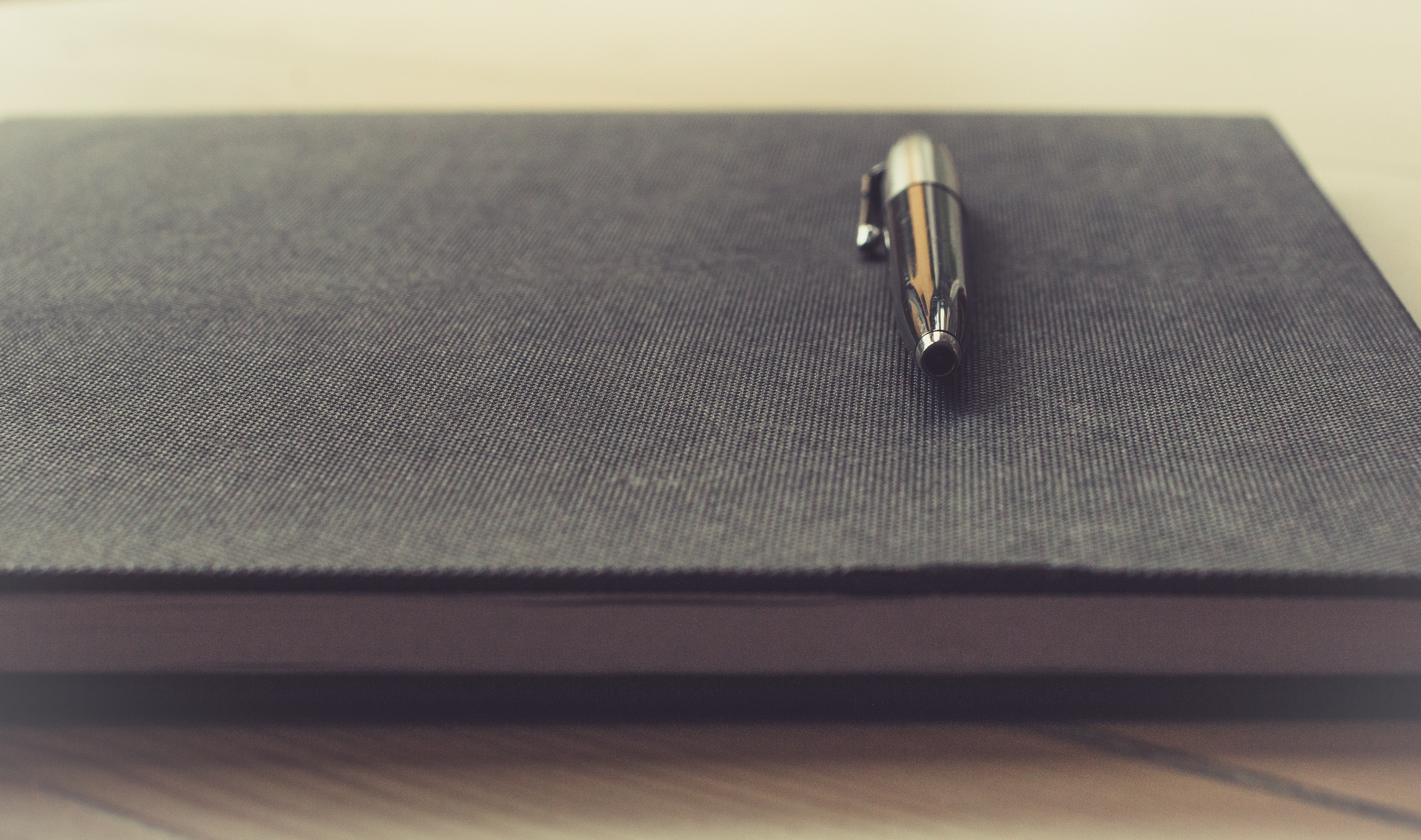La taxe Zucman, inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, a pour objectif de créer un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros. Elle toucherait ainsi une population restreinte, estimée entre 1 800 et 4 000 foyers fiscaux, soit environ 0,01 % des contribuables français, pour un rendement annuel évalué entre 15 et 25 milliards d’euros.
Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 20 février 2025, la proposition a ensuite été rejetée par le Sénat le 12 juin 2025. Les partisans de la réforme mettent en avant un outil de justice fiscale, destiné à limiter les stratégies d’optimisation qui permettent à certains très hauts patrimoines de réduire fortement leur contribution. Les opposants, au contraire, craignent un exil fiscal massif, une mesure jugée confiscatoire, et une atteinte à l’attractivité économique de la France.
Le texte prévoyait toutefois certains aménagements, notamment l’exclusion des biens professionnels comme ceux liés aux PME ou aux artisans, afin de ne pas entraver l’activité économique. Il instaurait également une règle spécifique permettant d’imposer les biens des ultra-riches jusqu’à cinq ans après un éventuel départ de France, afin de limiter les effets d’évitement fiscal.
Sur le plan juridique, la mesure soulève d’importantes questions de constitutionnalité, notamment au regard du droit de propriété et du principe d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi s’il estimait que le prélèvement est excessif. Face à ces incertitudes, le gouvernement explore des pistes plus modérées, comme l’instauration d’un impôt minimal différentiel à 0,5 % du patrimoine, excluant les actifs professionnels.
La taxe Zucman illustre ainsi un dilemme récurrent du droit fiscal : trouver un équilibre entre lutte contre les inégalités et préservation de la compétitivité économique. Pour l’heure, la mesure reste en suspens, son avenir dépendant autant des choix politiques que de sa faisabilité juridique.